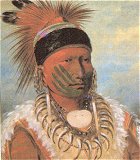
Objets d'étude : Argumentation : Convaince, persuader, délibérer.
Etudier le mouvement du siècle des Lumières.
Axes
- Les Lumières
- Le conte philosophique
- La question religieuse au XVI° siècle.
- Le roman d'apprentissage et le roman sensible.
Note : La problématique sera donnée par l'examinateur.
Texte 1 - Chapitre 1. { Début ➜ « Il parlait français fort inteligiblement » }
L'Ingénu est une des dernières œuvres de Volaire, écrite en 1767 à Ferney (Près de la Suisse) où il poursuit son combat contre l'Infâme (les injustices).
Le récit raconte les aventures d'un Huron (tribu indienne) débarqué en France.
Ses découvertes, qu'il analyse avec un bon sens naturel et un esprit critique aiguisé, lui permettent de mettre au jour les absurdités et les injustices du monde dans lequel il évolue.
(Lire le texte à voix haute)
Mouvements du texte
{Début à 7} ➜ Récit miraculeux, origine merveilleuse du prieuré de la montagne.
{9 à 48} ➜ Promenade des Kerkabon en bord de mer.
{48 à 61}➜ Portrait de l'Huron.
L'incipit se donne pour objectif de présenter le cadre, les personnages et les circonstances de leur rencontre.
Dans ce récit au statut problématique alternent les types de discours, les registres merveilleux, comiques et naturistes,
le fabuleux et le réel, les séductions du compte et l'éxigeance de vérité de l'auteur.
Problématique : En quoi peut on dire que cet incipit tient du conte philosophique ?
I - De la fantaise au réel - Un récit plaisant
1.1 - Le cadre spatio-temporel
| Lieux |
Date |
| Irlande,
petite montagne. |
Un
jour, Quand, Et, Encore |
| Notre
Dame de la montagne |
En
l'année 1689, le 15 Juillet au soir. |
| ➜
Début arbitraire ➜ Cadre spatio
temporel ambivalent entre légende et réalité. |
➜ Un
jour = Il était une fois. ➜ Références historiques
réeles. |
1.2 - Des procédés narratifs variés
Jeu sur le rythme du récit, passage lent ou rapide qui correpsondent à différents modes de narration. Ellipses et analepses sont au rendez vous.
On a aussi un sommaire (signifie raconter rapidement des évenements sans donner de détails).
La description de saint Dunstan est accompagnées de beaucoup de virgules et de verbes d'action.
Il y a une pause dans le temps pour la description de l'abbé l'arrivée des anglais.
Ellipse : Bond en avant dans le temps.
Toutes les ressources participent à l'interêt de la lecture, tournés vers le plaisir.
1.3 - Des personnages caricaturaux et pittoresque
L'abbé correspond au cliché du moine paillard : homme d'église qui sait s'ennivrer de plaisir. C'est un compromis entre la religion et la société.
Antithèse : Plaisir >< Religion. On note donc l'ecclectisme de l'abbé.
Le Huron : Innocence (Il est quasi-nu).
Mode différente (Sandales, tresses)
Bouteille de rhum et biscuit de mer ➜ Exotisme de pacotille.
Il parle français courramment, il est poli.
Certaines caractéristiques évoquent le voyage, le charisme du Huron mais aussi ses qualités morales : Civil et poli, il possède de l'instruction, et de l'aisance,
ce qui le prépare à son statut de héro. Il possède de la bonté et de la simplicité.
Les personnages sont pittoresque dont la caricature confine au comique.
➜ L'Ingénu s'ouvre donc par un récit bien mené, cherchant à attirer le lecteur par une maitrise parfaite de la narration et par le mélange d'élements merveilleux et réels.
Mais le philosophe fait montre d'une certaine distance face au composantes du récit.
2 - La mise à distance du récit
2.1 - La satire religieuse
Ambivalence du portrait des Kerkabon : Le spirituel est en retrait par rapport au sensuel.
« L'abbé s'ennuie en lisant St Augustin. » « Il était le seul bénéficiaire... »
2.2 - Une lecture ironique de la légende chrétienne
L'arbitraire de la logique : quelle motivation de fonder le prieuré ?
Désacralisation du spirituel.
Renversement burlesque de la locomotion.
« Irlandais de nation et saint de profession.»
Résistance de la superstition : « le nom qu'il porte encore »
➜ Voltaire remet en question la croyance en l'origine légendaire du monde et son acceptation näive par la population.
2.3 - Le récit à l'epreuve de la lecture philosophique
Des coïncidences doutes : Simultanéité de la promenade des Kerkabon et l'arrivée du Huron. Il atterit par hasard devant elle.
La discussion des Kerkabon porte sur la mort du frère et de la belle soeur au Canada.
Invraisemblance et arbitraire des événements. (Origine du prieuré et le fait qu'il soit étranger et qu'il parle français « fort intelligiblement ».
La visée du chapitre est contrariée (comment).
➜ L'explication des circonstances et des causes de la rencontre se transforme vite en une série de hasard.
Le philosophe interprète l'invraisemblance de son récit comme une manifestation de la pré-séance (domination) de l'arbitraire et du hasard dans l'ordre du monde.
Texte 2 : La rencontre du Huron avec les Huguenots
Support : Chapitre 8 - «Quand il fût à Saumur [...] combattre pour leur monarque »
S1. Le Huron, baptisé et héros vainqueur d'une bataille décisive contre les anglais s'en va briguer une faveur à la cour du roi.
En effet, il souhaite obtenir l'autorisation d'épouser Mmlle de St Yves, sa marraine.
"Conte philosophique"
« Conte » : Texte narratif.
« Philosophique » : Texte argumentatif (Critique religieuse catholique + critique politique, le Roi) + Texte polémique
Exemple de problématique : Comment le Conte Philosophique s'inscrit-il dans le réel pour dénoncer les abus de pouvoir ?
Saumur : Bastion des protestants.
1598 : Edit de Nantes (Les protestants sont libres d'exercer leur religion)
1685 : Révocation (annulation) de l'Edit de Nantes.
Dragons : Soldats qui forcent les protestants à se convertir.
1 - Du conte à la réalité - Un Huron à Saumur
1.1 - Le regard de l'Etranger
L'étonnement et la naïveté : Lexique de l'ignorance « Il s'étonna/qui ne savait pas le latin...» + De nombreuses phrases interrogatives.
| Naïveté |
Curiosité |
Ampathie |
| Il ramène la
guerre à un problème personnel (burlesque). |
« Il se fit
expliquer / Il ne manqua pas d'en parler » |
« Il versa
des larmes » |
1.2 - L'ancrage dans la réalité historique
Saumur, Angleterre nous ramène à la guerre civile.
L'ingénu a pu percevoir les deux cotés de la médaille puisqu'il a combattu contre les protestants anglais et partage la détresse des français.
× Les personnalités : Le Pape et le Roi de France.
× Évenements historiques : Révocation de l'édit de Nantes, référence militaire : L'Angleterre a composé plusieurs régiments.
× Informations chiffrées : 50k familles fugitives, 50k converties ; 600k sujets qui deviennent des ennemis.
1.3 - Ancrage dans la sociologie
ø Recensement de la population
ø Classe sociale : Drapiers et fabricants, pasteurs
ø Connaissance du latin et des textes antiques
ø Informés sur le point de vue poltique.
ø Maitrisent la rhétorique
ø Les persécutions : Champ lexical de l'éxil.
ø Registre pathétique
ø Oppression : Les dragonades : 50% converties.
2 - L'absolutisme en question
2.1 - Des roi sous influence
Le Pape dit qu'il est le maître des Rois. Comparatif d'égalité à leur égard : « Comme les autres grands Rois ».
Louis XIV, un roi manipulé, champ lexical du mensonge. Roi détaché de la réalité : Conditionnel : « Il aurait dit/penserait/ferait changer »
Comparaison ironique entre la conversion spirituelle des Protestants et la conversion d'un opéra par Lulli.
Texte 3 : La critique des jésuites
Support : Chapitre 16 (intégral)
Pour prix de ses services, le Huron est emprisonné à la Bastille à cause d'une lettre de cachet calomniseuse. Sa fiançée, Mlle de St Yves, sollicite sa libération auprès de Mr de St Pouanges. Effrayée par les propositions pressantes de son interlocuteur, elle va chercher refuge et conseil auprès du Père Toutatous son confesseur jésuite.
ø Mouvements du texte
La confession au Père / Le dilemme de Mlle de St Yves / L'indignation du jésuite qui accuse les jansénistes / Le revirement du jésuite / Un raisonnement immoral.
Thème : La corruption des jésuites et leur hypocrisie.
Genre : Conte philosophique
Registre : Pathétique, Satirique
(Comment l'auteur dénonce-t-il l'hypocrisie des jésuites ?)
Le père de la chaise = Confesseur du Roi.
Coulpe = Pêché volontaire entrainant la pertte de la grâce.
1 - Un cas de conscience
1.1 - Une héroïne vertueuse et aimante
-Preuve de vertu : Lecique de la morale : « honte/indignité/infidelié »
Religion : « Elle consulte un jésuite»
-Refus de l'infidelité, lexique du dégout : « répugnance/abominable »
-Amour envers l'Ingénu, mélange entre passion et amour légitime : « Mon amant/celui qu'elle devait épouser légitimement/l'amant qu'elle aimait »
1.2 - Un dilemme
-Un choix couteux : Lexique du coût : « demandait un grand prix de service/le délivrer au prix de ce qu'elle avait de plus cher »
→ Connotation de prostitution, de chantage.
Situation affligeante, registre pathétique : « pauvre fille/sacrifierait/je suis perdue quoique je fasse »
1.3 - Une héroïne tragique
-Une impasse : Double négation : « Je ne puis le laisser périr et je ne puis le sauver ».
Expression de la fatalité et de l'impuissance de l'héroïne.
Construction restricite : « Je n'ai que le choix du malheur ».
Style paratactique : « Ah non [...] sauver. » Poncutation rapide : Bouleversement de Mlle.
2 - Une argumentation spécieuse
2.1 - Un syllogisme à logique apparente
¹ C'est un époux à venir
² On ne peut tromper qu'un époux actuel
³ Ce n'est pas un péché
→ Construit sur un jeu de mot et sur des antithèses pout semer la confusion.
Amant >< Mari | Mondain >< Honnête | Intentions >< Réalité
Une structure concessive qui permet d'introduire l'invitation scandaleuse à l'adultère.
« Bien qu'il soit votre époux en idée, il ne l'est pas en fait, ainsi vous ne commetriez pas un adultère »
Discours immoral caché sous des apparences de pieté. « Adultère/pêché énorme/éviter »
Accumulation de connecteurs didactiques : « Premièrement, deuxièmement » etc qui peut rappeler nos dix commandements.
En apparence, le jésuite s'engage dans une défense de la moralité mais son insistance est douteuse.
2.2 - Une argumentation typiquement jésuite
Casuistique = Recherche des causes du mal.
Les Jansénistes croient en la prédetermination et au Destin, contrairement aux jésuites qui affirment pouvoir annuler les pechés (avec de l'argent par exemple).
La parole du Père Toutatous se veut universelle : Utilisation du présent de vérité générale.
Utilisation d'un apologue. Argument d'autorité.
2.3 - Une argumentation discreditée
Renversement burlesque : Du tragique à la trivialité.
Identification de l'apologue
Mr de St Pouanges = Richard
L'Ingénu = Pauvre homme
St Yves = La femme
Père Toutatous = St Augustin
Vacuité des conseils : Phrase négative : « Je ne vous conseillerai rien... »
Expression restrictive : « C'est tout ce que je puis vous dire »
Mlle de St Yves est livrée à « l'espoir ».
Finalement, le prêtre se montre impuissant.
3 - Un récquisitoire contre les jésuites
3.1 - Un orateur manipulateur
-Abus de confiance : La jeune fille confie à quelqu'un qui a autorité : Relation d'ascendance « confia/son bon confesseur » → Faiblesse de De St Yves.
-Un maître de la parole, un réteur : Accumulation des verbes de parole. Maitrise de l'émotion.
Le Jésuite feint de laisser à De St Yves son libre arbitre. Il est perverti par son hypocrisie.
3.2 - Un personnage hypocrite et caricatural
Onomastique parodique (Tout à tous) vient de la Bible.
St Paul : « Je me suis fait tout à tous pour les sauver tous ». Laxisme : Il accepte tout à tous.
(Peut-être une valeur ironique : Il n'aurait pas d'utilité).
Personnage versatile et oppurtuniste, c'est un protecteur des jésuites et fervent catholique.
Le jésuite manipule en lui disant une chose et son contraire : « Je ne vous conseillerai rien [...] il est à présumer que vous sez utile à votre mari ».
Autoritarsime pernicieux : Phrases impératives. Il semble que la faute soit une nécessité.
3.3 - L'accusation arbitraire contre les jansénistes
Attaque contre ses ennemis par le biais d'injures : « Abominables pêcheurs »
Dénonciation arbitraire : « C'est à coup sûr... »
T4 - Scène de reconnaissance
Support : Chapitre 2. « Le prieur et mademoiselle sourirent [...] s'amusait à boire dans la maison ».
1.1 - Une scène de reconnaissance
L'échange des portraits est semblable à une véritable expertise. Dramatisation.
1.2 - Une scène larmoyante et pathétique
-Registre pathétique : « Attendrissent/change de couleur/s'émut/tremblèrent/même émotion/saisis d'étonnement/pleurait/embrassant et versant des larmes ».
Tous ces mots s'opposent par antithèses avec « joie/riait » → Bouleversement émotionnel.
Parataxe : Changement rythmique, beaucoup de virgules et point-virgule qui donnent du rythme.
1.3 - L'édification d'un bonheur commun
Un air de fête : « boire/s'amusait ».
Une nouvelle harmonie sociale (validation collective). Anaphore de "Tous deux".
La scène de reconnaissance signe une nouvelle cohésion sociale. Une scène bénie sous le signe de la providence. Ce motif divin parcout le texte : « Ils admirent la providence/On alla rendre grâce à Dieu ».
Loin d'attribuer cet évenement au hasard, les personnages le rattachent à une volonté divine qui vient courroner le bonheur retrouvé.
2 - La parodie de la scène du genre
2.1 - La transgression des codes du genre
-Cette scène se trouve au début au lieu de la fin comme habituellement.
Elle ne résout donc aucune crise et se voit vidée de fonction et de sens.
-Les disonnances dans la validation des origines de l'Ingénu : Les portraits sont de très mauvaise qualité, Ironie sur « qui était grand physionnomiste » Hyperbole.
Ironie sur Mlle de St Yves également : « Qui n'avait jamais vu [...] assura ».
Logique absurde : « On était si persuadén si convaincu de la naissance de l'Ingénu qu'il consentit même à être neveu de Mr le Prieur ».
2.2 - Le tableau d'une émotion artificielle
Saturation/complaisance émotive. Hyperboles et gradations. Contagion collective et dangereuse de l'émotion (hystérie collective).
Plus l'émotion est grande, plus elle a une force de persuasion. Finalement, la démonstration du prieur repose plus sur l'expression des sentiments et permet peut être d'évacuer les preuves tangibles de l'origine de l'Ingénu.
PERSUADER : Faire adopter un point de vue à quelqu'un grâce à l'utilisation des sentiments et de l'émotion.
CONVAINCRE : Faire adopter un point de vue à quelqu'un en le raisonnant et en faisant appel à la logique.
2.3 - L'indifférence du Huron
-Une réaction par le rire contre l'émotion : « s'amusait/riait/joie ».
-L'indifférence et l'incrédulité : « ne pouvant s'imaginer/il consentit lui même à/d'un air indifférent ».
Les réactions de l'Ingénu invient à lire le passage avec un sourire distancé. Il s'agit bel et bien d'une parodie de scène de reconnaissance.
3 - Un retournement critique de la scène du genre
3.1 - Du bonheur commun au conformisme social
La contagion de l'émotion est une marque du conformisme (la volonté de faire de l'Ingénu quelqu'un de normal) et souligne une étroitesse d'esprit. Syntaxe de la réciprocité : « L'un l'autre/tous deux à la fois ».
3.2 - L'Ingénu reste un héros inclassable
-Flottement persistant sur ses origines : vocabulaire de l'indéfinition « en dépouillant quelque français/un huron soit neveu d'un prieur ».
-Gradation de l'incompétence dans le processus de la reconnaissance.
-L'Ingénu reste à l'écart de la liesse (joie) générale.
Le texte reste ambyvalent sur les origines du héros et conserve à l'Ingénu une part de mystère, propre au sauvage ou au héros picaresque qui fait échec aux tentatives de normalisation.
3.3 - La critique de la logique providencielle au prodit d'une logique de hasard
-L'indifférence et l'incrédulité de l'Ingénu s'opposent à la détermination divine.
-Peut-ê qu'il n'y a pas de hasard, créant le comique et met à distance la scène de genre.
L'entêtement de la société à trouver un sens aux origines de l'Ingénu traduit peut être une peur face à l'inconnu ou une crainte de l'homme livré au hasard des "enchainements" des évenements de ce monde. Le recours à Dieu permettrait alors de nier l'arbitraire.
→ Ce texte est résolument à veine parodique. Si pour le XVII siècle l'édification (moralisation) par le bias de l'émotion permet une validation sociale, Voltaire met en garde contre les manipulations ou les dérives qui peuvent en résulter au détriment de l'esprit critique. Néanmoins, il saura maitriser cet art sensible pour émouvoir son lecteur lorsqu'il évoque la mort de Mlle de St Yves au chapitre vingtième.
T5
1 - La mise en scène des moeurs sauvages
1.1 - La naïveté du personnage
-Mésusage de la langue, il confond « promis le mariage » avec « faire le mariage » : « Je vous épouse, en effet il l'épousait »
Le sens figuré est remplacé par le sens propre (concret) Le langage pour le Huron se traduit directement en action, ce qui crée des situations, des malentendus et des quiproquos.
-Sensibilité à la flatterie : « on l'adoucit par des paroles flatteuses/on lui donna des espérances/ce sont les deux pièges où les hommes des deux hémisphères se prennent » Là encore c'est la rhétorique qui trompe le Huron, on lui ment sans qu'il s'en rende compte.
1.2 - La brutalité
Champ lexical de la vigueur et de la force. C'est un Huron en pleine possession de ses moyens : « avait poussé/s'était élancé/possédait une vertu mâle et intrépide/le courage de l'assaillant/se défendit/yeux étincelants/firent trembler ».
Cette brutalité sauvage s'assimile à un véritable combat. Ici, amour et violences sont étroitement liées. Faut-il s'en choquer ou bien n'est pas pour les personnages une source de plaisir ?
-Une scène enlevée, une scène temporelle : « A peine l'Ingénu/il allait l'exercer/lorsqu'au » Expression imminence : « Je vous apprendrai/je vous remetrrai/il allait l'exercer/je vous épouse »
Par contraste, on doit calmer ses ardeurs : « cette vue modéra/on l'adoucit » → Ces indications traduisent les réactions imprévisibles, incontrolables mais déterminées du héros. L'Ingénu se montre comme étant extremement pressant.
1.3 - La valorisation de l'état de nature et le renversement des valeurs
Il regarde ces moeurs de manières péjorative. Un discredit jeté sur la pudeur de Mlle de St Yves, lexique négatif : « Il n'entendait pas raillerie/il ne comprennait pas ces façons là/impertinentes » → Série de tournures négatives : « Ce n'était pas /n'entendais pas raillerie/vous n'avez point de probité/vous ne voulez point »
-Une légitimation des privilèges de la loi naturelle >< Loi positive
Lexique du droit «probité/promis/lois de l'honneur/tenir votre parole/chemin de la vertu/je fais mon devoir/je remplis mes promesses »
Deux civilisations rentrent en confrontation et les valeurs occidentales s'en trouvent totalement inversées. Du point de vue du Huron, l'honnêteté devient malhonnêteté et promesses deviennent mensonges. La fureur du héros peut s'expliquer en partie par la violence des conflits culturels mis en scène dans ce texte.
2 - L'éducation de l'Ingénu
2.1 - Une entreprise de polissage
Def {Bienséance} → Ensemble des règles du savoir-vivre qui visent à n'avoir aucune attitude choquante.
-De la brutalité à la bienséance. Antithèse où la vigueur va venir s'opposer au mot suivant : « On le modéra/se rajusta/tout se passa dans la plus grande bienséance/malgré la situation décente »
-Modification rythmique : A la scène intime et cocasse succède une véritable leçon de morale pleine de didactisme, livrée par l'abbée. (« arrivé//épousait/débattu/exercé » >< des verbes de paroles : « voulut prouver/disait-il/répondit/je l'avoue »
La société police et passe donc par la méprise de la suprématie du langage.
2.2 - Une tonalité didactique, le personnage de l'abbé
Le vocabulaire de l'argumentation est assuré par l'abbée : « lui remontra/voulut prouver/résoudre cette difficulté » Une place laissée à la parole et aussi à l'écoute : Le pédagogue prend en compte les objections de son élève. Volonté de dénoncer de donner un discours unniversel :
-Tournures impersonnelles : « il faut des notaires/il y a beaucoup d'inconsistants/il y en aurait/il y a des âmes sages »
-Pronom impersonnel "on" : « Plus on est homme de bien, plus on doit s'y soumettre » → Style de la Maxime
Champ lexical du droit : « loi positive/les conventions/fait les lois/se soumettre aux lois »
L'abbée fait la promotion des lois sociales et se pense lui aussi dans son bon droit.
2.3 - La promotion de la bienséance et l'idéal de l'honnête
Criminalisation : « Sans les conventions faites entre les hommes, la loi de la nature ne serait presque jamais qu'un brigandage naturel »
La bienséance, un art de vivre en société : « S'ils étaient rassemblés dans une grande ville... » Les règles sociales sont donc nécessaires pour régir les comportements dès lors que les hommes se réunissent.
L'honnête homme se définit par la juste mesure : « Il y a, dit il, je l'avoue, beaucoup d'inconstants et de fripons parmi nous [...] mais il y a des âmes sages, honnêtes, éclairées [...] on donne l'exemple aux vicieux qui respectent un frein que la vertu s'est donné à elle-même.
